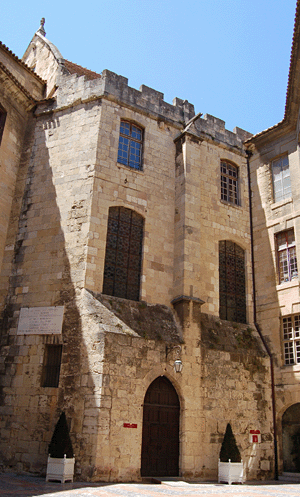|
François
Fouquet et Notre Dame de Marceille
|
|
|
|
Rappelons
que plusieurs chercheurs pensent aujourd'hui que François
Fouquet, frère aîné de Nicolas Fouquet, surintendant des finances,
fut mis au courant de la présence d'un trésor dans le Razès par un
autre frère : Louis, informé lui-même par le peintre Nicolas
Poussin.
Ce trésor, Nicolas Pavillon, évêque d'Alet l'aurait fait transférer sous Notre
Dame de Marceille où les Fouquet y puiseront dans un premier temps pour
arrondir les finances
familiales et construire Vaux-le-Vicomte, puis à l'arrestation du
surintendant, grossir les caisses de Louis XIV et ainsi maintenir
le prisonnier royal en vie !
A ces sombres desseins, François se serait fait nommer évêque de Narbonne
pour être au plus près de Limoux et de Notre Dame de Marceille, ville sous la
juridiction spirituelle de l'évêché narbonnais..
Ce scénario se heurte pourtant à de nombreuses invraisemblances.
|
|
|
|

|
|
François
Fouquet, Archevêque de Narbonne
|
|
|
|
Louis
Fouquet séjourne à Rome en 1655-1656. Il
est alors abbé de Saint-Martin d'Autun, du Jard, de Ham, de Sorèze et
de Vézelay. Au cours de son séjour romain, son frère Nicolas le charge
de collecter diverses oeuvres d'art, aidé en cela par Nicolas
Poussin, généreusement rémunéré.
Le 17 avril 1656, Louis adresse
à son frère Nicolas une lettre dans laquelle il évoque "des
avantages" que M. Poussin pourrait lui procurer...
Si Nicolas Fouquet achète le domaine
de Vaux avant son accession à la surintendance, alors qu'il n'est que
jeune maître des requêtes en 1641, le devis des transformations et embellissements
présenté par Louis Le Vau, assisté
de l'entrepreneur Villedo, est accepté le
2 avril 1656 (pour
600 000 livres pour le château et 257 000 livres pour les communs).(1)
On
peut donc raisonnablement supposer que tous les plans et prix furent
pensés bien avant. Il est bon aussi de se rappeler qu'à l'époque une
lettre, un voyageur ne mettaient pas deux jours pour arriver de Rome à
Paris.
Voilà qui écarte définitivement une décision de
travaux et donc de fortes dépenses prise à la suite
de la révélation de Nicolas Poussin.
|
|
|
|

|
|
Notre
Dame de Marceille - CPA Solaire Photo - Bordeaux
|
|
|
|
D'autre part, il aurait été nécessaire que François Fouquet puisse
mettre en place son circuit de remontée d'un hypothétique trésor
audois bien avant 1656 et pour cela s'assurer de la possession de Notre
Dame de Marceille ou pénétrer dans les terres de l'évêché d'Alet.
Or, cette fois, c'est l'abbé Joseph-Théodore Lasserre qui nous
renseigne dans son " Histoire de Notre Dame de Marceille"
publiée en 1891.(2)
S'il est exact que François Fouquet est le coadjuteur de l'évêché de
Narbonne dès le 8 décembre 1656, ce n'est qu'en 1659, alors qu'il
accède pleinement à sa charge d'archevêque, qu'il achète un terrain
proche de l'église... mais du côté Nord. Donc trois ans après la
fameuse lettre de Poussin supposée avoir révélé un trésor du côté
de Rennes-les-Bains. Cette même année 1659, le 25 juin Mazarin est
invité à visiter Vaux, le 14 juillet, c'est le Roi et sa mère qui
sont de la visite.
Un an plus tard, François Fouquet précise ses
intentions à propos de Notre-Dame de Marceille, très proche
de Saint-Vincent de Paul et membre actif de la dévote compagnie du
Saint-sacrement (3), il a le désir d'y bâtir un centre de
missionnaires qui manque pour le Bas-Razès.
Un acte épiscopal daté du 19 avril 1660 (soit 4 ans après la lettre
évoquant Poussin) nous donne les motivations de
l'archevêque :
"../.. perfectionner et instruire les
prêtres de la ville de Limoux et du Razès trop éloignés de la
capitale du diocèse. Ayant cherché un lieu convenable pour
l'instruction des dits prêtres et former des missionnaires, il fut
trouvé que Marceille, à cause de sa situation, de ses édifices et de
la dévotion des fidèles qui l'ont rendue fameuse et illustre depuis
longtemps remplirait ce but".
Il faut aussi comprendre que Nicolas
Pavillon à moins d'une dizaine de kilomètres de Limoux forme ses
propres missionnaires avec une ligne de conduite certes d'une stricte
rectitude mais qui ne correspond plus à l'esprit de la Compagnie du
Saint-Sacrement. François Fouquet cherche donc aussi à pondérer
certains "extrémismes".
Fort bien, mais là où le bas blesse, c'est qu'en 1660, l'administration
temporelle du sanctuaire n'appartient pas à Mgr François Fouquet et
donc à l'évêché de Narbonne, nous apprend l'abbé Lasserre, mais aux
consuls de la ville de Limoux toute proche et ce depuis fort longtemps
!
Cet état de fait ne se déroula d'ailleurs pas sans procès en 1551 et
en 1645, mais les consuls avaient le privilège d'élire ouvriers,
procureurs, bassiniers de l'œuvre, ermites, et prêtres nécessaires
pour recevoir les offrandes des pèlerins à charge d'une redevance
annuelle de 6 livres à solder au principal du collège des Doctrinaires
de Narbonne à Paris pour l'éducation des étudiants du diocèse.
Ce n'est qu'en 1662 (donc après l'arrestation de Nicolas Fouquet en
septembre 1661 et l'exil à Vezelay de François Fouquet) que par délibération, les consuls, autorisés par les
habitants de Limoux cédèrent l'église et toute son administration à
l'Archevêque.
C'est alors que commence la construction du bâtiment
pour les missionnaires. Ces derniers devaient être issus d'une congrégation
nouvelle : les frères de la doctrine chrétienne fondée en 1592 par
César de Bus, nous apprend Gilles Semenou. (4) Mais il n'exerceront
jamais dans le Notre-Dame de Marceille sous responsabilité de Mgr Fouquet. |
|
|
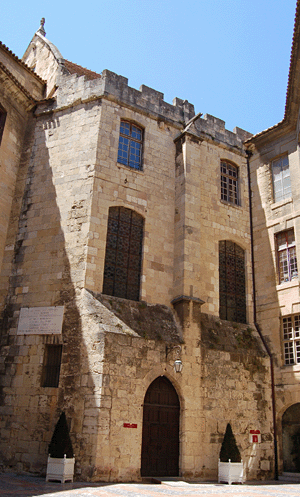 |
On comprend donc qu'il y a impossibilité juridique et administrative à
disposer avant 1662 du sanctuaire pour la famille Fouquet et encore plus
de cryptes qui ne purent être constituées avant cette date car les
consuls seuls avaient pouvoirs sur les lieux.
D'autre part, la carrière de
François Fouquet fut parfaitement menée, non sans calcul mais dans la plus grande
piété, il n'aurait pu faire illusion au sein de la compagnie du
Saint-sacrement, remettre au pas les prêtres impies, sans une dévotion
réelle.
Nommé pour succéder à Raymond de la Montagne à l'évêché de
Bayonne qui dépendait alors de l'Archevêché d'Auch en mars 1637
(alors que Nicolas Pavillon vient de se voir nommer évêque d'Alet), il
est ensuite transféré à Agde, où le 20 septembre 1658, il céda sa
place à son frère Louis et enfin à Narbonne où il accède à
la fonction d'Archevêque en remplacement de Monseigneur de Rebé,
membre de la Cie du St
Sacrement comme lui.
La province de Narbonne n' a rien à envier
à une autre province de France. Comprenant les diocèses de Narbonne,
Carcassonne, Béziers, Nîmes, Montpellier, Lodève, Usès, Saint-Pons,
Alet, Alès, et Perpignan, c'est une riche province et la charge de
l'archevêque dégage d'énormes bénéfices.
Président des
états généraux du Languedoc, l'archevêque de Narbonne avait ainsi un
poids considérable.
Laissant le petit évêché d'Agde (26 paroisses, ce
qui ne signifie pas pour autant qu'il rapportait moins qu'un autre évêché)
à son frère Louis, François réussit là un fort beau plan de
carrière.
Lorsqu'en
plein exil, il remettra en question cette montée au plus haut pouvoir,
soumis au doute, Nicolas Pavillon ne manquera pas de
l'interroger à propos de sa probité religieuse car on savait qu'il
avait joué sur quelques échanges de bénéfices pour arriver à ces
charges. Et en cela, il se trompait si peu !
Un certain Dupuis, homme d'affaire efficace et fort riche, installé à
Cornanel (aujourd'hui Cournanel) sur le diocèse d'Aler fut un des leviers sur lesquels s'appuya
Nicolas Fouquet pour faire accepter, dit-on à Mgr Rebé son frère
François comme Coadjuteur. Ce même Dupuis qui se signalera par son
oppositions violente à Nicolas Pavillon et finira par lui rendre
raison. (5) |
|
Cour
intérieure de l'évêché de Narbonne |
|
|
|
|
Si les rapports de Nicolas Pavillon et de François Fouquet furent au
début assez houleux, on doit à Nicolas Fouquet que rencontra Pavillon
à Toulouse où il était en visite avec la cour en 1659, le soin de réconcilier
les deux prélats. Leur brouille tenait essentiellement à une affaire
d'assiette fiscale l'un (Pavillon) désirant séparer Alet et son
diocèse de Limoux, l'autre (Fouquet) désirant l'y maintenir car ce
découpage lui était financièrement plus avantageux. C'est Nicolas
Fouquet qui donc résolut la dispute en incitant son frère à accepter
la séparation fiscale (5).
Les frères Foreau, ecclésiastique qui visitèrent le diocèse d'Alet
en 1666, nous apprennent la très grande estime en laquelle François
Fouquet tint très vite Nicolas Pavillon. L'archevêque de Narbonne
allant jusqu'à louer une maison jouxtant l'évêché pour passer
quelques temps à Alet. (6). Lors de la disgrâce du surintendant et de sa famille, François
Fouquet écrivit à Nicolas Pavillon plusieurs lettres extrêmement touchantes
où il lui demande de prier pour son salut, acceptant comme une grâce
du Seigneur l'exil où il est condamné, source de pénitences et de
transformations intérieures.
En 1664, après avoir donné raison à
Nicolas Pavillon lors d'un procès entre officiers de leurs diocèses
respectifs, il lui demande de l'aider à choisir de meilleurs
responsables. S'écartant ouvertement des mouvements de la cour, il lui
réaffirme sa confiance et sa considération, ce qu'il ne manqua pas de
faire jusqu'à sa mort.
Ces lettres n'étaient certes pas destinées à être diffusées ou
divulguées au monde, elles ne le furent qu'après le décès de leur
auteur, on comprendrait mal dès lors dans l'hypothèse d'un échange
matériel secret, un échange spirituel si confiant, admiratif et intime
entre
deux hommes que tout au contraire aurait du opposer.
Christian Attard |
|
|
Notes
et sources :
(1) - Michel le Moël, conservateur en chef des Archives nationales. Dictionnaire du
Grand Siècle, Fayard, 1990, p. 1571-1572
(2) - Joseph-Théodore Lasserre " Histoire de Notre Dame de
Marceille" Éditions Bélisane. p. 51
(3) - lire à ce propos "les annales de la Compagnie du
Saint-Sacrement" du Comte René de Voyer d'Argenson. p.181, 219 Éditions
de l'Oratoire. Marseille.
(4) - Gilles Semenou - Notre Dame de Marceille - Carcassonne1992.
p.14
(5) - Vie de M. Pavillon, Evêque d'Alet par Charles-Hugues Lefèbvre de
St Marc et Antoine de la Chassagne - 1738. voir le chapître
concernant les rapports des Fouquet avec Nicolas Pavillon.
(6) - Relation d'un voyage fait à Pamiers et à Alet par deux
ecclésiastiques. Édition Pomies Foix 1913 |
|
| Retour
vers la Reine |